Jeff Buckley ou l’art de la reprise
Vingt-cinq ans après sa mort, que retenir de la trace laissée par Jeff Buckley dans la grande Histoire de la musique ? À droite, le grand public, matraqué à outrance à grands coups de Hallelujah. À gauche, une audience plus avertie, qui aura exploré Grace plus en profondeur. Une certitude toutefois : rarement un artiste aura su s’approprier les créations des autres avec autant de justesse. Au point de faire de l’ombre aux enregistrements d’origine. Voilà bien une sérieuse ironie. Là où Jim Morrison, Jimi Hendrix, Janis Joplin ou Kurt Cobain jouissent d’une fascination romantique sans borne, difficile d’en dire autant de Jeff Buckley. Alors, quoi ? Parce qu’il n’est pas mort à 27 ans (mais à 30), son aura en serait ternie ? Peut-être. Sa musique est pourtant aujourd’hui unanimement reconnue. Un coup d’œil à sa discographie suffit d’ailleurs pour avoir une idée de ses nombreuses influences. Mais prenons les choses dans l’ordre.

De la Californie à Grace
Jeffrey Scott Buckley est né le 17 novembre 1966 à Anaheim, en Californie, de l’union de Mary Guibert et Tim Buckley, chanteur, guitariste et auteur-compositeur américain d’une certaine renommée. Oui mais voilà, le père abandonne femme et enfant, avant de mourir d’une overdose en 1975. Le petit Jeff ne le rencontrera qu’une seule fois. C’est donc son beau-père qui servira de figure paternelle, et qui l’introduira à Led Zeppelin, Pink Floyd, Queen, Kiss ou Jimi Hendrix.
Jeff rendra hommage à ces influences tout au long de sa carrière, jalonnée d’une pléthore de reprises. La bande de Robert Plant sera par exemple gratifiée d’une version humoristique de Kashmir lors d’un concert à l’Olympia en 1995. Il chantera aussi When the Levee Breaks, elle-même empruntée par le groupe de Londres à Kansas Joe McCoy et Memphis Minnie. Jimmy Page lui-même témoignera régulièrement de son admiration pour Buckley. Pas mal, comme adoubement.
Le Californien de naissance, New-Yorkais d’adoption, préfèrera souvent le live comme terrain de jeu et d’expérimentations. Son amour de l’exercice transpirait de manière évidente, partageant avec le public simplement, sans démesure. Grace est d’ailleurs son seul album studio paru de son vivant. Un véritable témoin d’histoire, salué par la critique à sa sortie, mais que seul le temps a permis d’apprécier à sa juste valeur.

L’Amérique, des racines et des lives
Revenons à ses influences. Au programme, Billie Holiday, Leonard Cohen, Prince ou Bob Dylan bien sûr, mais aussi la country, la musique de l’Amérique dite « profonde », teintée de blues, de chants religieux et de transmission orale.
Prenez Parchman Farm Blues. Un morceau d’abord enregistré par Bukka White en 1940, que l’on pourrait rapprocher du Folsom Prison Blues de Johnny Cash, dans la mesure où il adresse les conditions de détention du Mississippi State Penitentiary. Si vous vous le demandez, non, lesdites conditions n’étaient pas particulièrement agréables. Bukka White, à la différence de J. R. Cash, peut en témoigner. S’il en garde l’esprit « rocailleux », Jeff Buckley apporte à sa version une voix d’ange qui tranche radicalement avec la dureté des paroles.
Dans le même esprit, sa reprise de Strange Fruit de Billie Holiday incorpore une douceur bienvenue pour évoquer le lourd sujet du racisme et du lynchage des Afro-Américains. La comparaison avec les fruits d’un arbre est particulièrement dure et éloquente. Là encore, le live, à travers un jeu de guitare en forme de complainte, permet de soulager la brutalité du propos.
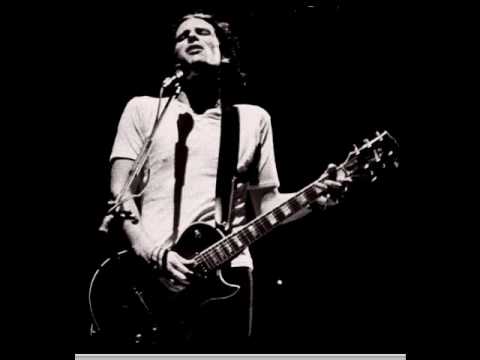
Nous sommes toujours en Amérique profonde, avec un thème récurrent : la route. Leon Payne enregistre en 1948 Lost Highway. Une aubaine pour Jeffrey Scott, dont l’interprétation avec des cordes pour seul accompagnement est une preuve suffisante de son génie vocal.
Car oui, Jeff Buckley a littéralement été touché par la grâce du chant. Sa voix, que l’on peut grossièrement qualifier de fausset, lui accorde une gamme qui lui permet de chanter à peu près n’importe quoi. Pratique. Surtout pour un artiste qui aura toujours fait passer sa composition et son lyrisme avant sa voix. Un véritable sacerdoce pour lui. Cette mélancolie dépressive et réconfortante est sa marque de fabrique. Il y eut Frankie Valli (« You’re just too good to be true »), il n’y aurait peut-être pas eu les mêmes Thom Yorke, Matthew Bellamy ou Lana del Rey sans Jeff Buckley.

Le faîte de son art, il l’atteint sûrement avec Corpus Christi Carol, un chant religieux transmis par tradition orale, dont les premières traces écrites remontent en Angleterre en 1504, rien que ça. Ici, on touche au sublime et on est transcendé par une interprétation spirituelle ramenant au sacré.
À mi-chemin de la road song et du gospel soul, on trouve enfin Calling You. S’attaquer à Jevetta Steele, pas le moindre des défis vocaux. Mais encore une fois, la maîtrise est totale. Une reprise habitée, bien que plus intimiste que la version originale, avec cette sensation de cadre feutré en bonus.

Amour, sexe et peines de cœur
Changement de registre. L’autre thème récurrent de la discographie de Buckley, c’est bien évidemment l’amour. Oui, c’est maintenant que l’on parle d’Hallelujah. À première vue, on reste dans le chant religieux. Un terme hébreu que l’on peut d’ailleurs traduire par « Louez le Seigneur ». Sauf que Leonard Cohen l’aurait écrite en slip sur la moquette de sa chambre d’hôtel, en pleine crise de la page blanche. Pour le sacré, on repassera.
Hallelujah, c’est avant tout l’expression de l’orgasme, ce qui explique le fameux « […] from your lips she drew the Hallelujah ». C’est donc l’amour charnel, l’érotisme dans sa forme la plus pure, la faiblesse humaine vis-à-vis de la chair qui sont évoqués.
Si l’orgasme est une petite mort, alors I Know It's Over est le parfait pendant d’Hallelujah. Une création originale de Morrissey bien sûr, autre sex-symbol, s’il en est. Mais à la lourde basse d’Andy Rourke, Jeff Buckley apporte sa réverbération et ses effets. Frissons garantis.

Côté peines de cœur, la mélancolie n’est pas en reste. Lilac Wine, écrite par James Shelton, chantée par Hope Foye et popularisée par Nina Simone, l’illustre idéalement. Si les interprétations sont multiples, le caractère de deuil, matérialisé par la perte de repères est prégnant.
Dans un registre similaire, il empruntera à Dylan Mama, You Been on My mind, complainte puissante d’un amour vain et douloureux.
Sur une note plus positive, The Way Young Lovers Do, titre de Van Morrison, aborde l’amour adolescent, naïf et plein d’espoir. Buckley s’écarte ici franchement de la version originale, notamment dans une mouture live enregistrée au Sin-é. Ce café de l’East Village était devenu l’un des repaires du Californien, dans lequel il gratifia son audience de représentations spectaculaires. Parmi celles-ci, Je n’en connais pas la fin, directement issue du répertoire d’Édith Piaf. Comme un symbole de l’étendue de ses influences. Il y chante même en français. Autre reprise de la Môme, l’Hymne à l’amour, qu’il adapte cette fois en anglais.
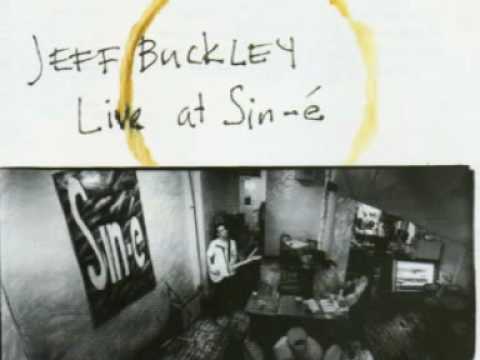
Écouter Jeff Buckley, c’est donc s’aventurer à travers les méandres de la poésie. Si vous cherchez de la mélancolie, vous en trouverez. De la force aussi. Son répertoire, impressionnant au regard de sa courte carrière, fait la part belle aux racines de la musique. Celle chargée d’histoires et de souvenirs. Mais Buckley lui-même s’éloignera des reprises sur la fin de sa vie, estimant que son apprentissage était terminé. Sketches for My Sweetheart the Drunk, compilation posthume, permet d’avoir un aperçu de ce qu’aurait été son deuxième album studio. Avec, toujours, ce romantisme exacerbé. N’en déplaise aux icones d’antan.







